De notre envoyée spéciale dans sa mémoire: Annie
Suc.
Jeudi, le jour de
la semaine où, à l'époque, il n'y avait pas d'école, ce jour-là, j'allais
avec ma mère et ma petite soeur au marché, chacune avec son couffin. Ma
mère c'était tous les jours qu'elle s'y rendait, mais mon jour de congé
scolaire c'était pour accompagner ma mère au marché. On y allait tôt le
matin, car elle disait que les gens qui s'y rendaient à midi, c'étaient
les pauvres ou les radins.
Après être sorties
de chez nous, au 30 de la rue Michelet, on était frappées par le soleil
juste en face dans la rue Tirman. Adjerri nous faisait traverser au passage
clouté. C'était un Algérien qui habitait au 35 et qui faisait office de
gardien d'immeuble. Et comme ce jour-là, il n'y avait pas d'agent pour
faire passer la rue aux enfants des écoles Tirman, Denise Ferrier et Clauzel,
c'était lui qui avait cette corvée, mais pour lui, je pense que c'était
un plaisir. Toujours impeccable dans sa gandoura et sa chéchia rouge sur
la tête, il était très grand, toujours le sourire et toujours un petit
bonjour. En passant devant lui, il nous disait toujours "ADJERRI, ADJERRI
!". Peut-être qu'en arabe cela veut dire "courrez !". Il était ainsi surnommé
dans le quartier : "ADJERRI". 
  
Cliquez pour agrandir
Le numéro 30 de la rue Michelet (photos : SLIM)
Nous voilà de l'autre
côté de la rue. On passait devant l'opticien, ensuite "La Dentelle du
Puy" (une vitrine toujours belle), et une petite bijouterie: "Denis".
On arrivait ainsi dans la rue Richelieu. Après la patisserie "chez Kummer",
on disait aussi "La Genevoise", se trouvait un épicier Mozabite, un "Moutchou".
Encore quelques pas, et c'était une grande épicerie de luxe, le luxe algérois,
"La treille d'Or". Grand magasin, grandes vitrines. L'intérieur très haut
de plafond. L'épicier en blouse blanche (très chic) et tout à fait en
haut de ces étagères qui montaient presque jusqu'au plafond, de très grandes
bouteilles, peut-être des vraies, remplies de Cognac, d'Armagnac ou de
liqueur.Elles donnaient l'impression d'être encore plus grandes, puisqu'elles
touchaient le plafond. En sortant à droite on avait une droguerie, Veber,
autant de marchandises dedans que dehors, devant la vitrine et sur le
trottoir, avec balais, seaux, échelles, sacs de graines, arrosoirs, tuyaux
et toute la quincaillerie...
Voilà enfin les escaliers
de la rue Drouët d'Erlon pour aller à ce fameux marché Clauzel, escaliers
séparés au centre par une rampe de fer où s'amusaient des gamins. Leur
jeu c'était de glisser sur la rampe à califourchon, les pantalons y laissaient
sûrement des morceaux. Quelques marches nous amenaient à un palier où
se trouvait un fleuriste, sa boutique c'était une grande caisse verte
haute comme un comptoir, protégée par un zinc, et sur le dessus des étagères
en escaliers. Le marchand était entouré par ses paniers en osier, remplis
de fleurs, et des seaux eux aussi remplis de plantes toutes aussi jolies
les unes que les autres. Quand nous passions devant lui il nous offrait
une fleur, un oeillet dont la tige s'était cassée.
En bas des marches
nous voilà dans la foule, dans le bruit, dans les odeurs et dans un arc
en ciel de couleurs.
|
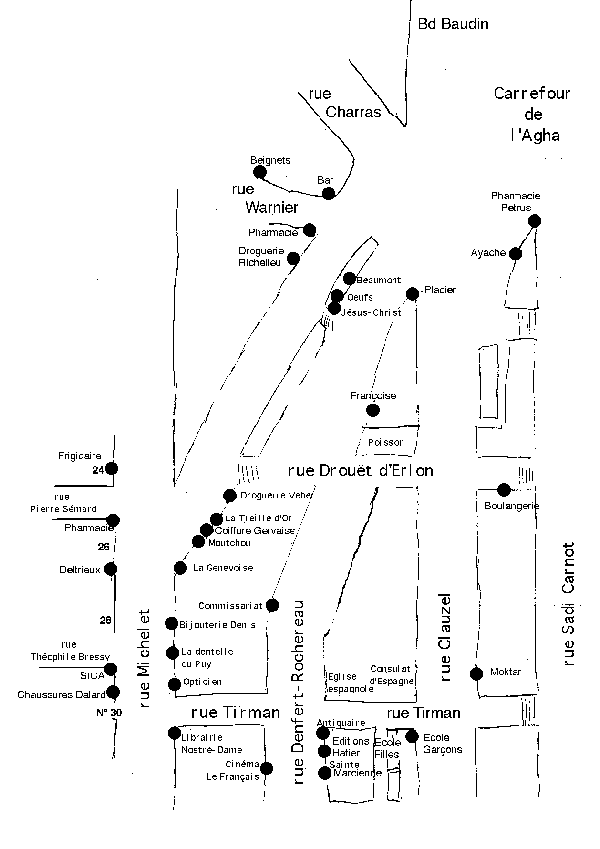
Cliquez pour agrandir le plan
 Nous, on a le souvenir d'un autre familier du quartier, un très
vieil homme, qui s'appelait Bachir, avec une courte blouse grise et un éternel turban jaune. Il passait de boutique en boutique, et mon père lui donnait à chaque fois un peu d'argent (à l'époque, la sienne de boutique était dans le haut de la rue Tirman, il représentait les livres scolaires des Editions Hatier; ensuite elle fut rue Denfert-Rochereau en face du cinéma Le Français). Quand je lui disais bonjour, Bachir faisait semblant de vouloir me faire peur, en retenant de force ma main dans la sienne, incroyablement noueuse et déformée. Mais dans son visage très ridé, avec la peau tannée comme celle d'un montagnard, ses petits yeux pétillaient de malice et de gentillesse, il me demandait "alors, toi t'y es le chacal de la Chenouah ?". Voilà, c'était Bachir. Bien plus tard, en 62, on m'a dit qu'il avait été tué dans un attentat contre un café. Mais était-ce vrai ? Je crois qu'hélas beaucoup de ces musulmans qui fréquentaient les quartiers européens, dont les commerçants des marchés, ont été assassinés aveuglément par les tueurs de l'OAS lors du premier semestre 62. "Adjerri", lui, aurait été recherché et assassiné peu après l'indépendance. (Gérald) Nous, on a le souvenir d'un autre familier du quartier, un très
vieil homme, qui s'appelait Bachir, avec une courte blouse grise et un éternel turban jaune. Il passait de boutique en boutique, et mon père lui donnait à chaque fois un peu d'argent (à l'époque, la sienne de boutique était dans le haut de la rue Tirman, il représentait les livres scolaires des Editions Hatier; ensuite elle fut rue Denfert-Rochereau en face du cinéma Le Français). Quand je lui disais bonjour, Bachir faisait semblant de vouloir me faire peur, en retenant de force ma main dans la sienne, incroyablement noueuse et déformée. Mais dans son visage très ridé, avec la peau tannée comme celle d'un montagnard, ses petits yeux pétillaient de malice et de gentillesse, il me demandait "alors, toi t'y es le chacal de la Chenouah ?". Voilà, c'était Bachir. Bien plus tard, en 62, on m'a dit qu'il avait été tué dans un attentat contre un café. Mais était-ce vrai ? Je crois qu'hélas beaucoup de ces musulmans qui fréquentaient les quartiers européens, dont les commerçants des marchés, ont été assassinés aveuglément par les tueurs de l'OAS lors du premier semestre 62. "Adjerri", lui, aurait été recherché et assassiné peu après l'indépendance. (Gérald)
|
|
De temps en temps
on trouvait à l'entrée du marché trois ou quatre hommes, originaires de
Mauritanie m'avait-on dit. C'était plus sûrement des ressortissants de
la petite communauté nègre, descendant des esclaves razziés par les arabes
ou les turcs d'Alger. Ils formaient un groupe de musiciens avec tam-tam
et des sortes de castagnettes en fer. Ils faisaient le tour du marché
en jouant leur musique. Ma mère elle aussi faisait un tour pour rien.
Rien, ce n'était pas vrai, car elle regardait la marchandise, les prix,
la qualité. Elle avait ses marchands qu'elle connaissait depuis longtemps.
Le tour pour rien se terminait à la poissonnerie où elle commandait son
poisson : bonites, dorades, ou rougets  , à Monsieur Tortora, dont la
voix dominait les autres pour attirer les clientes. Pour parler de sa
poissonnerie, on disait "Chez Gaëtan", comme ça, plus tard, on n'a pas
confondu avec son fils Raymond, quand il a réussi comme speaker sportif
à la télé d'Alger, et encore plus tard son petit fils Stéphane, qui s'est
fait un nom, ici en France, toujours à la télé et toujours comme chroniqueur
sportif (il est le rédacteur en chef d'un magazine sportif sur M6 !).
Comme quoi, du poisson aux ondes, il y avait pas loin ! Mais on reviendra
par ailleurs sur la dynastie des Tortora). L'odeur du poisson, des écailles
partout sur le sol, l'eau qui coulait des bancs de poissons. Enfant, je
me pinçais le nez. Vite, à l'air frais ! , à Monsieur Tortora, dont la
voix dominait les autres pour attirer les clientes. Pour parler de sa
poissonnerie, on disait "Chez Gaëtan", comme ça, plus tard, on n'a pas
confondu avec son fils Raymond, quand il a réussi comme speaker sportif
à la télé d'Alger, et encore plus tard son petit fils Stéphane, qui s'est
fait un nom, ici en France, toujours à la télé et toujours comme chroniqueur
sportif (il est le rédacteur en chef d'un magazine sportif sur M6 !).
Comme quoi, du poisson aux ondes, il y avait pas loin ! Mais on reviendra
par ailleurs sur la dynastie des Tortora). L'odeur du poisson, des écailles
partout sur le sol, l'eau qui coulait des bancs de poissons. Enfant, je
me pinçais le nez. Vite, à l'air frais !
Et maintenant, on
faisait le marché, les légumes, les fruits, ma mère discutait toujours,
soit de la qualité, soit du prix, il y avait toujours un petit arrangement,
le marchand de bananes nous offrait de petites bananes, celui qui vendait
les pastèques nous faisait goûter d'un cube rouge sortant d'une énorme
pastèque. En suivant la rue Cabot en direction du boulevard Baudin, il
me semble qu'il y avait un café, puis d'autres escaliers venant de la
rue Richelieu. Là aussi un fleuriste avait installé sa boutique en bois
peinte en vert wagon et ses bouquets. Cet escalier était plus court que
le premier, aussi le marchand de fleurs avait-il adossé son étalage contre
le mur, en bas à gauche, juste avant un épicier qui faisait l'angle formé
par l'escalier et la rue Cabot. Mais je n'ai pas oublié "Jésus Christ"
(on prononçait "jésukri"), l'épicerie mozabite, juste à l'autre angle,
à droite en regardant l'escalier. A elle seule c'était tout un roman.
Il fallait descendre
deux marches et là, on entrait dans la caverne d'Ali Baba. Jésus, c'étaient
des Mozabites tous de la même famille, avec leurs sarouels gris, leurs
visages portant barbe ou moustaches, et chéchias sur la tête. En bas de
ces deux marches on se frayait un chemin entre les sacs de jute, on restait
cloué par les odeurs d'épices, d'herbes. Tous les murs étaient recouverts
d'étagères remplies de conserves, de bouteilles, de boîtes d'allumetttes,
de morceaux de savon... Au plafond ils avaient accroché les réclames de
l'époque, des plaques en émail du chocolat Cémoi, Maggi cubes... Au sol
dans les sacs il y avait des haricots en grains, des pois chiches, des
noix, noisettes, cacahuètes, lentilles et toute la smala des légumes secs.
A gauche de l'entrée un petit meuble servait de comptoir : des ustensiles
de cuisine accrochés un peu partout, pas besoin de caisse enregistreuse,
tout était dans la tête. Lorqu'ils faisaient la note, inutile d'user crayon
et papier. La marchandise était souvent emballée dans du papier journal
et chaque fois je repartais avec une poignée de cacahuètes que je cassais
et grignotais en marchant.
On n'allait pas bien
loin : juste en sortant à gauche se trouvait le marchand d'oeufs. Lui,
c'était mon préféré. "Il était grand, il était beau, il sentait le sable
chaud...". Non! Mais vrai, il était toujours habillé de blanc, sarouel,
gandoura et turban, aussi blancs que les oeufs qu'il vendait. Il avait
une belle voix grave, était bel homme, très grand, toujours impeccable,
courtois et souriant. Lui non plus n'avait pas besoin de machine à calculer,
il comptait aussi bien le prix des oeufs cassés, les pas cassés, les fêlés,
les pas fêlés, les frais, les coques, etc... Toujours debout, majestueux,
là au milieu de ses montagnes d'oeufs. Je l'écoutais compter sans papier
ni crayon, au fur et à mesure il emballait chaque oeuf dans l'éternel
papier journal, journal qu'il découpait avec un couteau en petits carrés
pour protéger les oeufs, on aurait dit de gros bonbons en papillottes.
Il nous serrait la main, et on continuait. |
 "Et aussi des "gallinettes" (littéralement: "petite poule", autre nom des daurades ?), que maman faisait au four avec du vin blanc, et quelques autres choses comme des rouelles de pommes de terre et d'oignons émincés, des tomates, quelques gousses d'ail, des champignons de Paris, que c'était un festin !" (Pierre). C'est bien simple, rien que ce nom de Tortora, c'était la promesse de tortorer de première, et le jeu de mots il est d'autant plus facile que l'association d'idées elle venait toute seule, l'évidence, le ça va d'soi ! "Et aussi des "gallinettes" (littéralement: "petite poule", autre nom des daurades ?), que maman faisait au four avec du vin blanc, et quelques autres choses comme des rouelles de pommes de terre et d'oignons émincés, des tomates, quelques gousses d'ail, des champignons de Paris, que c'était un festin !" (Pierre). C'est bien simple, rien que ce nom de Tortora, c'était la promesse de tortorer de première, et le jeu de mots il est d'autant plus facile que l'association d'idées elle venait toute seule, l'évidence, le ça va d'soi !
Les deux photos ci-dessous : ce que voyait Annie quand elle sortait de chez elle, 30 rue Michelet : juste en face, la rue Tirman et l'église espagnole à l'angle de la rue Denfert-Rochereau (photo prise en septembre 84). Un peu plus bas que l'église sur la gauche : les palmiers du jardin du consulat d'Espagne, à l'angle de la rue Clauzel.

Cliquez pour agrandir

Juste en face du n°30, faisant l'angle de la rue Tirman et de la rue Michelet : la librairie "A Nostre-Dame" (enseigne en lettres gothiques dorées sur marbre noir), où Camus, quand il habitait la rue du Languedoc toute proche, venait feuilleter des livres (photo années 50). A l'autre angle, au 35 (hors champ, donc), un opticien qui resta longtemps après l'indépendance (il était encore là en 1984), dans l'immeuble où habitait Patrick Artoni, condisciple de certains d'entre nous.
|
|
Juste à côté, une
charcuterie : "chez Beaumont où tout est bon". Que ça sentait bon, que
c'était beau, les jambons, les saucissons, les soubressades.... les grappes
de boudin accrochées en haut des étagères, et à hauteur d'yeux, les cocas,
les pâtes, les raviolis ! Toujours beaucoup de monde. Chaque fois il fallait
faire la queue  . .
Après Beaumont on
allait de l'autre côté du marché, faire quelques achats à la pharmacie
PETRUS  , presqu'à la sortie du marché, au bout de la rue Clauzel du
côté de l'Agha. En revenant dans le marché, ma mère s'arrêtait chez le
marchand de tissus Monsieur Ayache, un petit bonhomme avec de petites
lunettes posées au bout d'un grand nez, et là, c'étaient des discussions
à n'en plus finir; car ma mère faisait de la couture et elle lui achetait
tissus, fermetures éclair, boutons, fils, et toutes les fournitures dont
elle avait besoin. Il avait un étalage sur le trottoir devant son magasin.
Il servait plusieurs clientes en même temps. Sa caisse était dans la boutique.
A lui tout seul il faisait tourner son entreprise, et ça discutait toujours,
soit du prix qui n'était pas indiqué, soit de la qualité, il devait calculer
son prix au coup par coup. Ce n'était jamais dans le silence ou dans le
calme. Sacré Ayache ! , presqu'à la sortie du marché, au bout de la rue Clauzel du
côté de l'Agha. En revenant dans le marché, ma mère s'arrêtait chez le
marchand de tissus Monsieur Ayache, un petit bonhomme avec de petites
lunettes posées au bout d'un grand nez, et là, c'étaient des discussions
à n'en plus finir; car ma mère faisait de la couture et elle lui achetait
tissus, fermetures éclair, boutons, fils, et toutes les fournitures dont
elle avait besoin. Il avait un étalage sur le trottoir devant son magasin.
Il servait plusieurs clientes en même temps. Sa caisse était dans la boutique.
A lui tout seul il faisait tourner son entreprise, et ça discutait toujours,
soit du prix qui n'était pas indiqué, soit de la qualité, il devait calculer
son prix au coup par coup. Ce n'était jamais dans le silence ou dans le
calme. Sacré Ayache ! |
 Rémi Morelli se souvient du slogan entier qui figurait sur le papier
d'emballage rose : "Ne pleure pas, gros cochon, tu cours chez Beaumont où tout est bon". Le slogan s'adressait à un porcelet éploré en larmes. Poignant. Chez les Dupeyrot, on allait plutôt chez Llioret (chez eux, on prononçait : "Lioré", et chez les Morelli : "Liorète"). Rémi Morelli se souvient du slogan entier qui figurait sur le papier
d'emballage rose : "Ne pleure pas, gros cochon, tu cours chez Beaumont où tout est bon". Le slogan s'adressait à un porcelet éploré en larmes. Poignant. Chez les Dupeyrot, on allait plutôt chez Llioret (chez eux, on prononçait : "Lioré", et chez les Morelli : "Liorète").
 "En fait, à un moment donné, la pharmacie avait changé une nouvelle
fois de nom (pour lequel ?), mais ma mère continuait de dire, comme sûrement
tous les habitants du quartier : "je vais à la pharmacie Petrus". (Annie) "En fait, à un moment donné, la pharmacie avait changé une nouvelle
fois de nom (pour lequel ?), mais ma mère continuait de dire, comme sûrement
tous les habitants du quartier : "je vais à la pharmacie Petrus". (Annie)
|
|
Et ensuite on rentrait
dans un marché couvert, une sorte de couloir assez large avec des marchands
de chaque côté : boucherie, charcuterie, crèmerie, fabrique de pâtes....
Après avoir passé ce bâtiment on retrouve les marchands de fruits et légumes,
les paniers se remplissent. Puis on arrive dans un autre marché couvert
: dès l'entrée on passait devant le bureau du placeur. Dans ce bâtiment,
c'était le domaine des volailles, des oeufs, des produits de la ferme
et des tripes. On achetait à Françoise des tripes. Pendant que ma mère
discutait avec elle, moi, je choisissais les tripes à carreaux, les losanges,
les plissés, quel jeu ! Je ne savais pas d'où provenaient les tripes.
D'autres commerces... La marchande de volailles qui nous gardait le sang
caillé des poulets, que ma mère nous faisait cuire à la poêle avec de
l'ail et du persil. Que c'était bon! Dans les cages, serrées comme des
sardines, de pauvres poules, des dindes, des canards, attendaient qu'on
vienne les libérer pour finir dans la casserole. En sortant de cette ferme
avec ses odeurs de basse-cour, on allait se refaire une odeur de poisson.
Les chaussures étaient trempées d'eau rouge avec écailles, nous retrouvions
notre marchand, ma mère prenait son poisson, toujours emballé "papier
journal", et on remontait les escaliers avec nos paniers arabes, pleins
de couleurs, d'odeurs. Un petit au revoir et à demain au marchand de fleurs.
En remontant la rue
Richelieu, en passant je jetais un oeil sur les grandes bouteilles de
la Treille d'Or, où les gens aisés pouvaient se procurer du lait pasteurisé
en provenance de la métropole. Encore quelques pas, et là on s'arrêtait
dans un lieu magique pour le palais : la boulangerie- patisserie Chez
Kummer, "La Genevoise". Une grande et haute marche, puis trois ou quatre
marches plus petites nous séparaient de ce paradis de la patisserie-confiserie
et de l'odeur du pain. Quelle odeur ! Ça embaumait tout le quartier! En
pénétrant dans le magasin à droite, un grand comptoir vitré où s'alignaient,
bien rangés par deux, les gâteaux et les fameux croissants fourrés pralinés.
Pendant que ma mère faisait la queue à l'autre comptoir pour le pain,
moi j'achetais les croissants qu'on mangeait à quatre heures pour le goûter.
Ce n'était pas pour le petit déjeuner, mais pour la gourmandise. Côté
boulangerie derrière le comptoir, un escalier qui descendait au four,
et quand la porte s'ouvrait et que Monsieur Kummer remontait avec des
plateaux couverts de gâteaux ou de viennoiseries, qu'il portait sur sa
tête en tenant des deux mains, les narines étaient au paradis, caressées
par l'odeur du pain chaud et croustillant. Quel artiste, ce monsieur!
La porte de ce lieu sacré était toujours ouverte. Le pain chaud venait
finir la tournée du marché et il avait le privilège de se retrouver sur
le dessus du couffin de ma mère. Sur le mien trônait la poche en papier
avec le petit Poulbot dessiné par Germaine Bourret "Mangez des gâteaux
plus souvent!"  . . |
 "Nous, chez Kummer on achetait des tranches de roulés au citron "qu'on aurait mangé sur la tête d'un galeux", disait ma mère, et aussi ce qu'on appelait "des langues de chat", longues comme le doigt, un peu comme du massepain de macaron, mais à la fois très friable et très tendre, au chocolat, et moëlleuses ! A tomber par terre!" (Gérald). "Nous, chez Kummer on achetait des tranches de roulés au citron "qu'on aurait mangé sur la tête d'un galeux", disait ma mère, et aussi ce qu'on appelait "des langues de chat", longues comme le doigt, un peu comme du massepain de macaron, mais à la fois très friable et très tendre, au chocolat, et moëlleuses ! A tomber par terre!" (Gérald).
|
|
Cette fois on traversait
la rue Richelieu pour se retrouver à l'angle de la rue Michelet, au deuxième
passage clouté, devant le magasin tout rouge "Frigidaire". Une banque
venait faire l'angle avec la rue Pierre Sémard, petite rue à traverser.
Et nous revoilà devant une pharmacie Jacomo, et le marchand de journaux
et tabac Deltrieux. On posait les couffins sur le trottoir, ma mère me
donnait de l'argent et elle continuait les quelques mètres qui nous séparaient
de la maison avec les deux paniers. Moi pendant ce temps, je rentrais
chez Deltrieux pour acheter les cigarettes à mon père, ce fameux petit
paquet bleu. Je crois qu'il était surnommé Jeannot Deltrieux, il y avait
aussi ses parents, tous les trois adorables, souriants, et très gentils
commerçants. Avec le peu de monnaie qui restait je choisissais carambars
et autres friandises. Un petit au revoir à ces trois gentilles personnes
et me voilà seule pendant quelques instants pour faire les 50 mètres,
en passant devant une vitrine de tissus d'ameublement "Décor" et une vitrine
de livres qui fait la coupure avec la rue Théophile Bressy.
Ah! voilà la SICA,
grand magasin d'électro-ménager. Tous les appareils étaient blancs, alignés
et rangés par catégorie. Une dernière vitrine, les chaussures Dalard,
vitrine pour Monsieur, vitrine pour Madame, tout cela protégé du soleil
par un grand store en toile rouge.
Me revoici au 30
de la rue Michelet. Deux marches, une grande, immense porte en fer forgé,
avec des barreaux sur les parties fixes. Très lourde porte quand il faut
la pousser ou la tirer. Un pas de plus, et je suis dans le hall de l'immeuble,
avec son dallage fait de grands carreaux noirs et blancs où je joue à
la marelle. L'ascenseur m'attend, je vous laisse.
Au revoir!
Annie Suc
Bordeaux, 2 décembre 1999.
|
Et vous, quels souvenirs gardez-vous du marché Clauzel ?
Comment pourriez-vous vous joindre à cette promenade d'Annie ?
Auriez-vous des documents à nous confier, le temps de les incorporer
à cette ballade ?
|





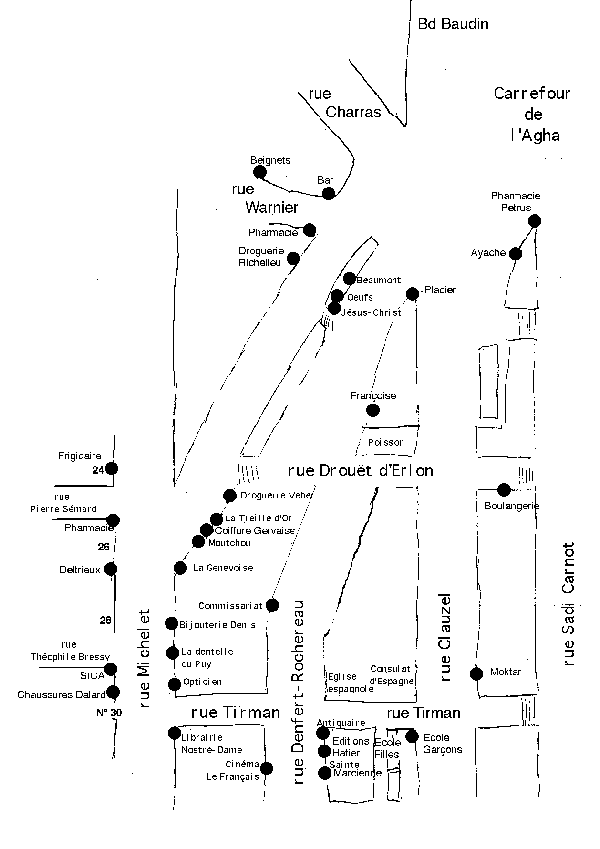
 , à Monsieur Tortora, dont la
voix dominait les autres pour attirer les clientes. Pour parler de sa
poissonnerie, on disait "Chez Gaëtan", comme ça, plus tard, on n'a pas
confondu avec son fils Raymond, quand il a réussi comme speaker sportif
à la télé d'Alger, et encore plus tard son petit fils Stéphane, qui s'est
fait un nom, ici en France, toujours à la télé et toujours comme chroniqueur
sportif (il est le rédacteur en chef d'un magazine sportif sur M6 !).
Comme quoi, du poisson aux ondes, il y avait pas loin ! Mais on reviendra
par ailleurs sur la dynastie des Tortora). L'odeur du poisson, des écailles
partout sur le sol, l'eau qui coulait des bancs de poissons. Enfant, je
me pinçais le nez. Vite, à l'air frais !
, à Monsieur Tortora, dont la
voix dominait les autres pour attirer les clientes. Pour parler de sa
poissonnerie, on disait "Chez Gaëtan", comme ça, plus tard, on n'a pas
confondu avec son fils Raymond, quand il a réussi comme speaker sportif
à la télé d'Alger, et encore plus tard son petit fils Stéphane, qui s'est
fait un nom, ici en France, toujours à la télé et toujours comme chroniqueur
sportif (il est le rédacteur en chef d'un magazine sportif sur M6 !).
Comme quoi, du poisson aux ondes, il y avait pas loin ! Mais on reviendra
par ailleurs sur la dynastie des Tortora). L'odeur du poisson, des écailles
partout sur le sol, l'eau qui coulait des bancs de poissons. Enfant, je
me pinçais le nez. Vite, à l'air frais !

 .
.
 , presqu'à la sortie du marché, au bout de la rue Clauzel du
côté de l'Agha. En revenant dans le marché, ma mère s'arrêtait chez le
marchand de tissus Monsieur Ayache, un petit bonhomme avec de petites
lunettes posées au bout d'un grand nez, et là, c'étaient des discussions
à n'en plus finir; car ma mère faisait de la couture et elle lui achetait
tissus, fermetures éclair, boutons, fils, et toutes les fournitures dont
elle avait besoin. Il avait un étalage sur le trottoir devant son magasin.
Il servait plusieurs clientes en même temps. Sa caisse était dans la boutique.
A lui tout seul il faisait tourner son entreprise, et ça discutait toujours,
soit du prix qui n'était pas indiqué, soit de la qualité, il devait calculer
son prix au coup par coup. Ce n'était jamais dans le silence ou dans le
calme. Sacré Ayache !
, presqu'à la sortie du marché, au bout de la rue Clauzel du
côté de l'Agha. En revenant dans le marché, ma mère s'arrêtait chez le
marchand de tissus Monsieur Ayache, un petit bonhomme avec de petites
lunettes posées au bout d'un grand nez, et là, c'étaient des discussions
à n'en plus finir; car ma mère faisait de la couture et elle lui achetait
tissus, fermetures éclair, boutons, fils, et toutes les fournitures dont
elle avait besoin. Il avait un étalage sur le trottoir devant son magasin.
Il servait plusieurs clientes en même temps. Sa caisse était dans la boutique.
A lui tout seul il faisait tourner son entreprise, et ça discutait toujours,
soit du prix qui n'était pas indiqué, soit de la qualité, il devait calculer
son prix au coup par coup. Ce n'était jamais dans le silence ou dans le
calme. Sacré Ayache ! .
.