Né en février 1946, Pur produit du "baby boom", je suis issu d'une famille de musiciens, chance que je n'ai mesurée que bien après que j'eus quitté l'enfance. Le mercredi après-midi, dans la salle du cinéma Rex (rue Horace Vernet), j'étais un fidèle et attentif auditeur des concerts de l'Orchestre Symphonique d'Alger, dans lequel mon père tenait sa place de violoncelliste. Souvent ma mère et ma soeur venaient me chercher devant l'école de la rue Clauzel qui bruissait encore à cette heure un peu tardive des cris de gamins prolongeant la récréation, répondant à ceux stridents des hirondelles, avant la studieuse "étude" si bien nommée.
Il est vrai qu'à cette époque le rituel du concert ressortait pour moi davantage d'une corvéee, à laquelle j'aurais bien volontiers échappé pour poursuivre dans la cour des activités plus ludiques à mon goût, que d'une patiente initiation musicale et culturelle, distillée à mon insu par mes parents, et dont je suis bien aise aujourd'hui. Est-ce alors par pur atavisme musical ou pour extérioriser une vitalité débordante dont la cour d'école n'avait pu venir totalement à bout, toujours est-il que, de façon systématique et sans aucun complexe, j'assistais au concert debout au premier rang du premier balcon, sans quitter des yeux le timbalier dont je mimais, avec paraît-il un certain talent, les moindres gestes ? C'est ainsi que je fus, fort justement, surnommé par les musiciens amusés et les mélomanes avertis "le timbalier".
Mes interventions gestuelles, surtout lorsque le répertoire s'y prêtait - ah, l'orage du troisième mouvement de la Pastorale! - n'échappèrent pas à Pierre Eyral, Directeur des programmes, je crois, et par ailleurs comédien talentueux bien connu du monde artistique algérois. "Etes-vous disposés à me prêter votre fils ?" demanda-t-il un jour à mes parents médusés. "J'ai besoin d'un enfant de son âge pour jouer le rôle de Dino del Moro dans la Reine Morte de Montherlant que nous montons pour la télévision". Eux étaient perplexes. Moi, je n'étais pas chaud : après l'épreuve du concert, il allait falloir maintenant que je travaille des poésies pour tester mes éventuelles compétences de comédien en herbe ! Je préférais nettement la cour de récréation où je faisais aussi l'acteur, mais à ma façon !
Pierre Ayral choisit "Le Chat, la Belette et le petit Lapin". Ce choix n'était pas anodin : tenter d'exprimer la subtilité des sentiments animaliers décrits par La Fontaine, et la ruse gastronomique du chat Raminagrobis, constitue en effet une excellente initiation pour qui veut transmettre avec réalisme le caractère retors du page favori d'Inès de Castro. C'est du moins ce dont je tentais de me persuader en travaillant mon texte, en vue d'une audition prochaine fixée à quelques jours de là dans les locaux de Radio Algérie, situés rue Hoche, juste en face de l'entrée du lycée Gautier. Le grand jour arriva, une fin d'après-midi.
Ma mère se souvient encore aujourd'hui
d'une dernière halte, qui faillit être définitive, sur un banc du boulevard
Victor Hugo, presque en face du domicile de mon camarade de classe Henri
Portier  : convaincu que j'étais de ne
pas savoir mon texte, terrorisé à l'idée d'avoir à le dire devant plusieurs
personnes, je voulais renoncer et rentrer au plus vite à la maison.
: convaincu que j'étais de ne
pas savoir mon texte, terrorisé à l'idée d'avoir à le dire devant plusieurs
personnes, je voulais renoncer et rentrer au plus vite à la maison.
Quels trésors de persuasion ma
mère dut-elle employer, quelles folles promesses me fit-elle pour m'amener
à changer d'avis ? Je ne sais. Toujours est-il qu'elle sut, je suppose,
trouver les mots justes ou les injonctions comminatoires : mon audition
leur parut convaincante, sous réserve d'exercices quotidiens. Rendez-vous
fut pris pour les premières répétitions au boulevard Bru, dans les locaux
flambant neuf de la toute nouvelle Télévision Française  .
.
Ici, à peine cette dernière indication
consignée, ma mémoire hésite : je crois me souvenir en effet que les premières
répétitions, consistant à lire la pièce, eurent lieu encore rue Hoche
 , où je crois aussi avoir aperçu le jeune
Guy Bedos, les studios du boulevard Bru n'ayant peut-être été inaugurés
que plus tard. Il me semble me souvenir aussi que la Générale, toujours
hors caméras, eut lieu dans la salle du Foyer Civique, situé au Champ
de Manoeuvres. Je me demande même si l'atmosphère confinée du studio de
télévision ne fut pas pour nous une découverte du tout dernier moment.
Incertitudes liées aux ruses de la mémoire évoquées plus haut...
, où je crois aussi avoir aperçu le jeune
Guy Bedos, les studios du boulevard Bru n'ayant peut-être été inaugurés
que plus tard. Il me semble me souvenir aussi que la Générale, toujours
hors caméras, eut lieu dans la salle du Foyer Civique, situé au Champ
de Manoeuvres. Je me demande même si l'atmosphère confinée du studio de
télévision ne fut pas pour nous une découverte du tout dernier moment.
Incertitudes liées aux ruses de la mémoire évoquées plus haut...
Peut importe d'ailleurs l'endroit précis, puisqu'il me faut maintenant raconter ce que mon souvenir a conservé des rencontres avec des hommes et des femmes faisant profession de comédien, de réalisateur, de photographe, de décorateur, de caméraman, de costumier ou d'accessoiriste. Un monde dont j'ignorais tout et auquel je me devais de m'intégrer en perdant ce qui faisait une partie de moi-même : l'accent pied-noir.
Ceux qui ont eu la chance de l'avoir savent combien il leur a été à la fois difficile et douloureux de le perdre. Ceux qui l'ont perdu, même sans effort, savent aussi combien, en des circonstances particulières, il ressurgit comme le naturel revenant au galop.
C'est Paul Robin Benhaioun qui assurait la réalisation de cette dramatique, qui serait proposée aux téléspectateurs algérois en direct et sans enregistrement simultané. Cette double précision pour montrer à la fois la difficulté de l'entreprise (pas de droit à l'erreur, pas de trou de mémoire), et sa volatilité (pas de « mise en boite », donc pas de conserve, pas d'archive). De cette soirée du vendredi 15 février 1957, si magique pour moi, il ne reste donc rien, aucun support matériel, et je le déplore. Si, peut-être quelques traces jaunies dans le cerveau sélectif et bien irrigué de quelques privilégiés d'alors, à la fois possesseurs d'un poste de télévision et amateurs de théâtre : double rareté. Cela doit faire bien peu.
En outre, et quoi qu'on fasse, leur nombre, comme celui des survivants de la Grande Guerre, tend forcément vers zéro. Puisse mon récit rendre cette courbe fatale définitivement asymptotique.
Mais en même temps, quel luxe,
quelle débauche de moyens, quel gâchis même... Pareille entreprise serait-elle
concevable aujourd'hui ? Avoir tant travaillé, tant investi, tant répété
 et tant souffert, pour trois heures d'un
seul soir, pour une seule et unique représentation ! Où donc étaient les
archivistes de l'audiovisuel, les collectionneurs d'images, les faiseurs
d'actualités ? Que reste-t-il aujourd'hui de ces débuts, prometteurs,
mais combien éphémères, de la télévision française en Algérie ? Quelles
traces, quelles archives ? Peut-être faut-il au contraire se consoler
de cette irrémédiable absence ? (...)
et tant souffert, pour trois heures d'un
seul soir, pour une seule et unique représentation ! Où donc étaient les
archivistes de l'audiovisuel, les collectionneurs d'images, les faiseurs
d'actualités ? Que reste-t-il aujourd'hui de ces débuts, prometteurs,
mais combien éphémères, de la télévision française en Algérie ? Quelles
traces, quelles archives ? Peut-être faut-il au contraire se consoler
de cette irrémédiable absence ? (...)
Paul Robin Benhaioun, le réalisateur donc, avait un tic professionnel, une véritable manie : joignant les deux pouces à l'horizontale et dressant les deux index perpendiculairement, il délimitait ainsi un champ, comparable à celui de la visée de la caméra imaginaire, au travers duquel il mesurait les effets dramatiques de telle ou telle scène et en déterminait le mouvement. Fut-il un grand réalisateur ? Je ne peux répondre à cette question aujourd'hui, mais il est sûr qu'à l'époque, si elle m'avait été posée, j'y aurais répondu plus que positivement. J'ai encore dans l'oreille le zézaiement de sa voix haut perchée, un peu décalée dans un physique rondouillard.
"La Reine morte" raconte l'histoire d'un mariage impossible parce qu'imposé, autrement dit celle de l'échec de l'amour face au politique : Ferrante, roi du Portugal, décide de marier son fils Pedro à l'infante de Castille dans l'intention toute calculée de rapprocher les deux pays. Logique et raison d'Etat. Malheureusement, Pedro refuse à son père cet arrangement et ne peut que le lui refuser : en effet, il s'est clandestinement marié avec Inès de Castro, de plus enceinte de ses oeuvres. Logique des coeurs, raison des corps. Double impasse. Apprenant ce mariage inopportun, Ferrante tentera de le faire annuler par le Pape; ce dernier, assumant pleinement ses fonctions pontificales, refuse (nous ne sommes pas encore à Monaco, ni à l'époque des compromis rémunérés avec le Ciel). En l'occurrence, seule la mort d'Inès peut rompre ce lien indissoluble. Ferrante se résoudra-t-il à ordonner ce meurtre libérateur ?
Que va-t-il privilégier : le bonheur de son fils ou l'avantage de son peuple ? A-t-il même le choix ? L'incompatibilité entre fonction et parenté, le hiatus entre son image publique et son quant-à-soi privé vont-ils lui laisser le moindre interstice de liberté ? Telle est, résumée et donc appauvrie, l'intrigue de cette dramatique dont le titre même laisse augurer du pire en donnant pratiquement la réponse avant que la question ne se pose...
A force d'assister aux répétitions, ma mère, ma sÏur et moi connaissions toutes les répliques par cÏur. Celles de Robert Party : «partie à tort, partie à raison.. », consonnance qui nous amusait; celles, torturées, de Jean Davy, dans le rôle de Ferrante, venant de donner l'ordre fatal : «Des multitudes d'actes, pendant des années, naissent d'un seul acte, d'un seul instant. Pourquoi ? (...) Quand elle regardait les étoiles, ses yeux étaient comme des lacs tranquilles... ». Pour ne rien dire des miennes : « Dino del Moro... Pour vous servir, Madame... Quoique... ce ne soit là qu'un surnom. Mon père est Fernando de Calla Fuente, marquis de Duero. Il gouverne la province du Genil. Mais on l'appelle Fernando del Moro parce que, ayant découvert que son intendant, un Morisque, continuait les pratiques païennes, il le poignarda de sa main. Mon père, il a la force de deux chevaux», tirées d'un dialogue capital entre le page et Inès, tenu devant la cheminée à l'intérieur de laquelle la caméra nous surprenait en contre-plongée, violant notre intimité... Agenouillé devant le feu que j'alimentais, j'offrais à l'objectif mon visage de face, tandis que la reine venait lentement se placer derrière moi avec l'intention manifeste de me questionner habilement.
Mais je les avais entendues, elle et l'Infante, au deuxième acte, dire à mon sujet : «Quelqu'un à moi s'est occupé des pages qui étaient hier à la porte du conseil... Deux des pages ne savaient rien, ou n'ont rien voulu dire. Le troisième, le plus jeune, avait écouté,bien écouté». Inès : «Le plus jeune ! Celui qui est si beau !». L'infante : «Un jeune démon est toujours beau».
J'avais alors la certitude - elle dure encore - que mes répliques, confiées dans le secret de l'âtre, modifiaient le cours de l'intrigue, voire celui de la vie d'Inès. Toujours au deuxième acte, préparant notre entretien, l'Infante ne m'avait-elle pas décrit, outre ma beauté, comme une incarnation démoniaque : «Alors, ma chère, si vous ne voulez pas regarder vers le ciel, tournez vous d'un coup vers l'enfer. Essayez d'acquérir le page, qui est d'enfer, et de savoir par lui les intentions du Roi. Il s'appelle Dino del Moro. Il est Andalou. Les Andalous ne sont pas sûrs. Il trahira tout ce qu'on voudra ».
Bref, je croyais mon rôle déterminant dans ce drame de grandes personnes où, sans avoir l'impression de trahir qui que ce soit, je jalousais instinctivement Pedro, doublement responsable, selon moi, de la mort programmée de sa belle : ne l'avait-il pas épousée en cachette et, impardonnable audace, engrossée sans autorisation paternelle ? Tout de même, quand on est fils de roi ! Quelque part entre illusion et réalité, l'indignation me suffoquait.
Habillé en page, culotte gonflante
et courte cape de velours cramoisi, gants et collants blancs, chaussures
vernies noires à boucle et à bout carré, je portais une perruque bouclée
embellie de fils d'or : «Et ces fils d'or et d'argent entremêlés à vos
cheveux ? », demandait Inès. Moi : «C'est aussi ma mère qui me les entremêlait
ainsi quand j'étais petit. Elle disait que c'était pour me porter bonheur».
Inès : «Quel âge avez-vous ? ». Moi : «Treize ans». Elle : «Vous dites
treize. Ce doit donc être douze, car il faut avoir l'air grand. Douze
ans ! Vous êtes un petit homme, avec déjà tout votre pouvoir de faire
du mal....». Maquillé comme une femme (pas
habitué que j'étais aux artifices de la scène et des caméras, c'est l'impression
que je me faisais), j'éprouvais néanmoins un trouble sensuel devant le
décolleté confortable, attirant et délicatement parfumé de la belle Inès
qui palpitait pour un autre. Ce trouble, que je craignais visible, ne
m'a jamais vraiment quitté. C'est, je crois, de cette époque que date
la certitude de ma banale mais radicale hétérosexualité.
Je sais que je fus beaucoup photographié,
à la sortie des loges. Seulement pour l'innocence de l'enfance ? Peut-être
pour la beauté du diable dont parlait l'Infante ? Nulle trace probante
n'en subsiste aujourd'hui...
Mais l'engrenage tragique et
inexorable du texte (Ferrante n'est pas un plaisantin), ainsi que mes
émois secrets devant tant de nouveautés offertes à ma jeune curiosité,
quelquefois se trouvaient soudain interrompus par une franche rigolade.
Le cameraman, dont la nouveauté
du métier, associée à l'emploi de l'anglais, décuplait à mes yeux le prestige,
était la cause de ces rires. Sans doute recruté sur place comme moi, il
n'était pas, lui, interdit d'accent local. Et il venait d'adresser à son
assistant tireur de câbles un impérieux, sonore et catégorique « traveling
fissa ! » que l'on se gardera bien de traduire !
Cette expression fit le tour
des studios et peut-être d'Alger. Ne résumait-elle pas à elle seule toute
le sel du mélange des cultures; n'est-elle pas grosse de tous les espoirs,
pas seulement linguistiques, que génère toute association, et pas seulement
de mots ? (...)
Le générique défilait au rythme
régulier d'une main déplaçant latéralement des cartons peints empilés
sur un pupitre, sous l'Ïil puissant et chaud d'un projecteur. Le roi Ferrante
: Jean Davy; Inès de Castro : Madeleine Delavaivre; Pedro : Pierre Gallon,
de la Comédie Française; Egas Coelho : Robert Party; la mise en scène
: Paul Robin Benhaioun... Que d'autres noms dont je voudrais encore me
souvenir ! Que d'émotions, de surprises, de sourires, procurerait aujourd'hui
la liste complète de ces comédiens, dont certains devenus entre-temps
célèbres et qui ne l'étaient pas, ou bien moins, à l'époque...
Ce soir-là, la main anonyme qui
révélait pour chaque rôle son acteur ne tremblait pas : pas de doute possible,
Dino del Moro était bien interprété par Rémi Morelli qui, lui, tremblait
vraiment.
La télévision frustre de l'ivresse
des applaudissements, de la chaleur du contact physique et laisse un arrière
goût d'inachevé, alors que le théâtre se nourrit de la présence de son
public. Après notre spectacle, équivoque et improbable «théâtre-télévisé»,
dont personne dans le studio ne savait comment il avait été au même moment
perçu en ville, et le silence imposé par la lampe rouge attestant que
le plateau était encore à l'antenne pour quelques instants, il fallut
attendre, décostumé, démaquillé, dépouillé, dédoré, l'arrivée des parents,
des amis, des critiques, de Pierre Eyral qui me félicita, trop rapidement
à mon gré, en me passant une main distraite dans les cheveux.
Pourtant, je voulais conserver
en moi, le plus longtemps possible, l'atmosphère de la scène finale dont
je ne résiste pas, peut-être pour la préserver toujours, à rapporter l'essentiel.
Ferrante s'adresse à ceux qui, sur sa demande, ont envahi le Palais :
«Messieurs, dona Inès de Castro n'est plus. Elle m'a appris la naissance
prochaine d'un bâtard du prince. Je l'ai fait exécuter pour préserver
la pureté de la succession au trône, et pour supprimer le trouble et le
scandale qu'elle causait dans mon Etat... (Il passe la main sur son front
et chancelle).
Oh ! Je crois que le sabre de
Dieu a passé au-dessus de moi...». (Suit la scène où Ferrante, mourant,
désigne Egas Coelho (qui tente de sauver Inès après en avoir machiné la
mort) à la vindicte publique).
"O mon Dieu ! dans ce répit qui
me reste, avant que le sabre repasse et m'écrase, faites qu'il tranche
ce noeud épouvantable de contradictions qui sont en moi, de sorte que,
un instant au moins avant de cesser d'être, je sache enfin ce que je suis".
Ferrante attire Dino del Moro (c'est à dire moi) et le tient serré contre
lui.
Il faut avoir vécu des moments
pareils pour comprendre ce que je tente de restituer ici : les postillons
de Davy sur mon visage et ses yeux subitement devenus glauques, me faisaient
croire à la présence réelle du sabre de Dieu ! Il continuait : "Que l'innocence
de cet enfant me serve de sauvegarde quand je vais apparaître devant mon
Juge. N'aie pas peur, et reste auprès de moi, quoi qu'il arrive... même
si je meurs... Dieu te le rendra, Dieu te le rendra, mon petit frère...
- Bien meilleur et bien pire... (Il se lève) - Quand je ressusciterai...
- Oh ! le sabre ! le sabre ! - Mon Dieu, ayez pitié de moi !" (Il s'écroule).
Dino del Moro (c'est à dire moi, toujours) mettant un genou en terre devant
le cadavre du Roi: «Le Roi est mort !».
Au privilège d'avoir prononcé
cette dernière réplique, définitive, d'avoir en quelque sorte eu le dernier
mot, s'ajoutait la conscience orgueilleuse de focaliser l'attention du
spectateur pendant toute la dernière scène muette dont Montherlant donne
toutes les indications sous forme de didascalies détaillées : «Extrême
confusion. Voix diverses. Au milieu de ce tumulte, on apporte sur une
civière Inès morte, pendant que des cloches sonnent. Le tumulte à l'instant
s'apaise. En silence, tous s'écartent du cadavre du Roi étendu sur le
sol, se massent du côté opposé de la scène autour de la litière, à l'exception
de Dino del Moro (moi, comme vous le savez) qui, après un geste d'hésitation,
est resté un genou en terre auprès du Roi. A ce moment apparaît don Pedro;
il se jette contre la litière en sanglotant. Le lieutenant Martins entre
à son tour, portant un coussin noir sur lequel repose la couronne royale.
Pedro prend la couronne et la pose sur le ventre d'Inès. Puis il se tourne
vers l'officier des gardes; celui-ci dégaine; tous les gardes font de
même et présentent l'épée. Alors Pedro force par son regard l'assistance
à s'agenouiller; le Prince de la Mer ne le fait qu'à regret. Pedro s'agenouille
à nouveau, et, la tête sur le corps d'Inès, il sanglote. L'assistance
commence à murmurer une prière. A l'extrême droite, le corps du roi Ferrante
est resté étendu, sans personne auprès de lui, que le page andalou (oui,
oui, c'est moi) agenouillé à son côté. Le page se lève avec lenteur, regarde
longuement le cadavre, passe avec lenteur vers la civière, hésite, se
retourne pour regarder encore le Roi, puis, se décidant, va s'agenouiller
avec les autres, lui aussi, auprès de la civière. Le cadavre du Roi reste
seul». RIDEAU.
Je croyais mon rôle déterminant,
ai-je dit. Il me semble ne pas avoir changé d'avis. Vanitas, vanitas !
A ce moment précis, dans le vacarme
mondain des compliments de circonstance succédant au silence dramatique,
encore empli de ce que je venais de vivre, vidé par la peur rétrospective,
démuni de mes oripeaux, loin de ma reine, gonflé d'autosatisfaction et
surpris de me voir si peu fêté, je me sentis bien seul et bien triste.
C'est que, croyant cette exaltante aventure terminée à jamais, je retrouvais
subitement, une fois les feux de la rampe éteints, ma médiocre et banale
condition d'enfant de tous les jours. Après avoir côtoyé des princes vivants
et de royaux cadavres, il me faudrait, dès le lendemain matin, on serait
samedi, reprendre le chemin de l'école. (...)
A quelques années de là, mon
père m'apprit l'élection de Montherlant à l'Académie Française, institution
dont je ne connaissais indirectement l'existence que grâce aux célèbres
lunettes, très photogéniques sinon justement académiques, de Marcel Achard.
Il me suggéra de lui adresser mes compliments et de profiter de cette
occasion pour lui dire que j'avais interprété le rôle du page. Je n'ai
pas gardé copie de ma lettre, mais voici ce qu'il me répondit par retour
du courrier, daté du 7 avril 1960 (enfin une référence ayant date certaine
par la foi du cachet postal) sur un petit bristol blanc : « Merci à mon
jeune camarade pour ses félicitations. Je suis content que vous ayez gardé
un bon souvenir de ce petit coquin de Dino del Moro. Tous mes meilleurs
sentiments » (...).
En des périodes plus propices
et moins traumatisantes, j'ai lu comme tout le monde la plupart des romans
de Montherlant et vu représenter une grande partie de son théâtre. Si
je dois avouer que cette littérature ne correspond pas vraiment à mes
goûts, la simplicité et la gentillesse de sa réponse m'allèrent à l'époque
droit au cÏur. Le fait même qu'il me répondît personnellement, sans utiliser
les services de son secrétaire, me surprend en sa faveur encore aujourd'hui.
Le « jeune camarade » était et
reste flatteur et flatté. Pouvait-il cependant ramener son page à un simple
«petit coquin» ?
J'en fus un peu déçu...
Rémi Morelli, 1999. La carrière d'enfant-comédien
de Rémi n'allait pas en rester à ce 15 février 1957. Lors de notre automne
1957, il est en 6ème au lycée Gautier, et il a déjà en vue son prochain
rôle dans l'Antigone d'Anouilh, montée par le CRAD. La première des deux
représentations, ce sera pour le 26 février 1958, notre année radieuse !
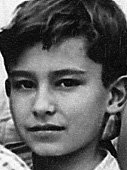
Rémi, parmi ses camarades de classe du Cours Moyen 2ème année, école Clauzel, en 1956-57. (voir "nous autres")
 : cette année scolaire
là, Henri Portier n'était pas avec nous en CM2 à Clauzel. Nous retrouverons
Henri à Gautier, en sixième, le 1er octobre 1957 (NDLR).
: cette année scolaire
là, Henri Portier n'était pas avec nous en CM2 à Clauzel. Nous retrouverons
Henri à Gautier, en sixième, le 1er octobre 1957 (NDLR).
 : la toute première de
la télévision à Alger, ç'avait été seulement le 25 décembre 1956. Il semble
qu'un certain retard avait été pris dans la mise en place de la télé en
Algérie. Si "La Reine Morte" ne fut pas la première pièce à être enregistrée
(d'autres l'avaient été dès 1956), peut-être fut-elle en tout cas la première
diffusion d'une dramatique en direct. A vérifier, nous n'en sommes qu'au
début de nos recherches.
: la toute première de
la télévision à Alger, ç'avait été seulement le 25 décembre 1956. Il semble
qu'un certain retard avait été pris dans la mise en place de la télé en
Algérie. Si "La Reine Morte" ne fut pas la première pièce à être enregistrée
(d'autres l'avaient été dès 1956), peut-être fut-elle en tout cas la première
diffusion d'une dramatique en direct. A vérifier, nous n'en sommes qu'au
début de nos recherches.
 : la raison pour laquelle
les répétitions avaient pu être pertubées dans les locaux de la rue Hoche
et se trouver transportées ailleurs, est peut-être la bombe FLN qui y
explosa, sans faire de victimes, mais avec des dégâts importants (plastic
!), un peu avant 21 heures, le lundi 14 janvier, soit vraisemblablement
quand le programme des répétitions avait débuté, ou peu avant (NDLR).
: la raison pour laquelle
les répétitions avaient pu être pertubées dans les locaux de la rue Hoche
et se trouver transportées ailleurs, est peut-être la bombe FLN qui y
explosa, sans faire de victimes, mais avec des dégâts importants (plastic
!), un peu avant 21 heures, le lundi 14 janvier, soit vraisemblablement
quand le programme des répétitions avait débuté, ou peu avant (NDLR).
 : les répétitions de "la
Reine Morte" et sa diffusion se situaient en pleine "bataille d'Alger"
(ce qu'il est convenu depuis d'appeler "la première bataille d'Alger").
: les répétitions de "la
Reine Morte" et sa diffusion se situaient en pleine "bataille d'Alger"
(ce qu'il est convenu depuis d'appeler "la première bataille d'Alger").
Voici quelques dates repères de ce qui se passait dans notre ville, cet
hiver 1957 :
-28 décembre, vendredi, 9h50, devant le 108 rue Michelet : assassinat d'Amédée Froger, Président des maires d'Algérie, par Ali-la-Pointe.
-29 décembre, samedi : obsèques d'Amédée Froger. Tout au long du parcours, épouvantables, ignobles "ratonnades".
-7 janvier : retour d'Egypte, la 10ème Division Parachutiste du général Massu prend possession d'Alger. La "bataille" commence.
-14 janvier, lundi : bombe à Radio-Algérie, rue Hoche.
-16 janvier : attentat au "bazooka" contre le général Salan, à la Xème région, place Bugeaud. Son aide de camp est tué.
Les auteurs, des activistes européens, seront bientôt identifiés.
-26 janvier (samedi), vers 17H25 : bombes FLN dans les cafés "L'Otomatic" (2, rue Michelet), la"Cafeteria" (juste en face, au 1ter rue Michelet) et le "Coq Hardi" (6, rue Charles Péguy, à peine plus loin). 4 morts, 60 blessés. Rémi Morelli habite au 21, rue Michelet, et Rémy Labreuil au 4, rue Charles Péguy.
-28 janvier : les paras de la 10ème D.P. "cassent" en quelques jours la grève générale décrétée par le FLN en vue du débat sur l'Algérie qui devait s'ouvrir ce jour à l'ONU (il a été reporté d'une semaine).
-10 février (dimanche après-midi) : bombes FLN au stade d'El-Biar et au stade municipal de Belcourt : 10 morts, 36 blessés.
-12 février : Fernand Iveton (ou Yveton), militant communiste, condamné pour une tentative d'attentat à la bombe contre l'usine à gaz, est guillotiné à la prison Barberousse à Alger.
-15 février : la résolution votée par l'Assemblée Générale de l'ONU ne condamne pas la France, c'est un échec pour le FLN. Rémi joue Dino del Moro dans "La Reine Morte".
-25 février (lundi) : arrestation de Larbi Ben M'hidi, un des "six fils de la Toussaint", avenue Claude Debussy. Sous la pression du dispositif des parachutistes, et de leurs succès, les autres membres du "CCE" (Abane Rhamdane, Krim Belkacem, Ben Khedda) quittent Alger, y laissant Yacef Saadi à la tête de l'organisation politico-militaire FLN.
-le colonel Bigeard fait rendre par ses hommes les honneurs militaires à Ben M'Hidi, qu'il doit remettre à une autorité française supérieure.
-3 mars : Larbi Ben M'Hidi est "suicidé" dans des conditions à ce jour toujours non élucidées.
-dans Alger, la recherche par les hommes de la 10ème D.P. du renseignement à tout prix - "la question" - se pratique à grande échelle. Entre le 18 janvier et le 15 avril, les réseaux FLN sont quasiment anéantis. Les estimations du nombre des "disparus" diffèrent : des centaines, peut-être des milliers.